
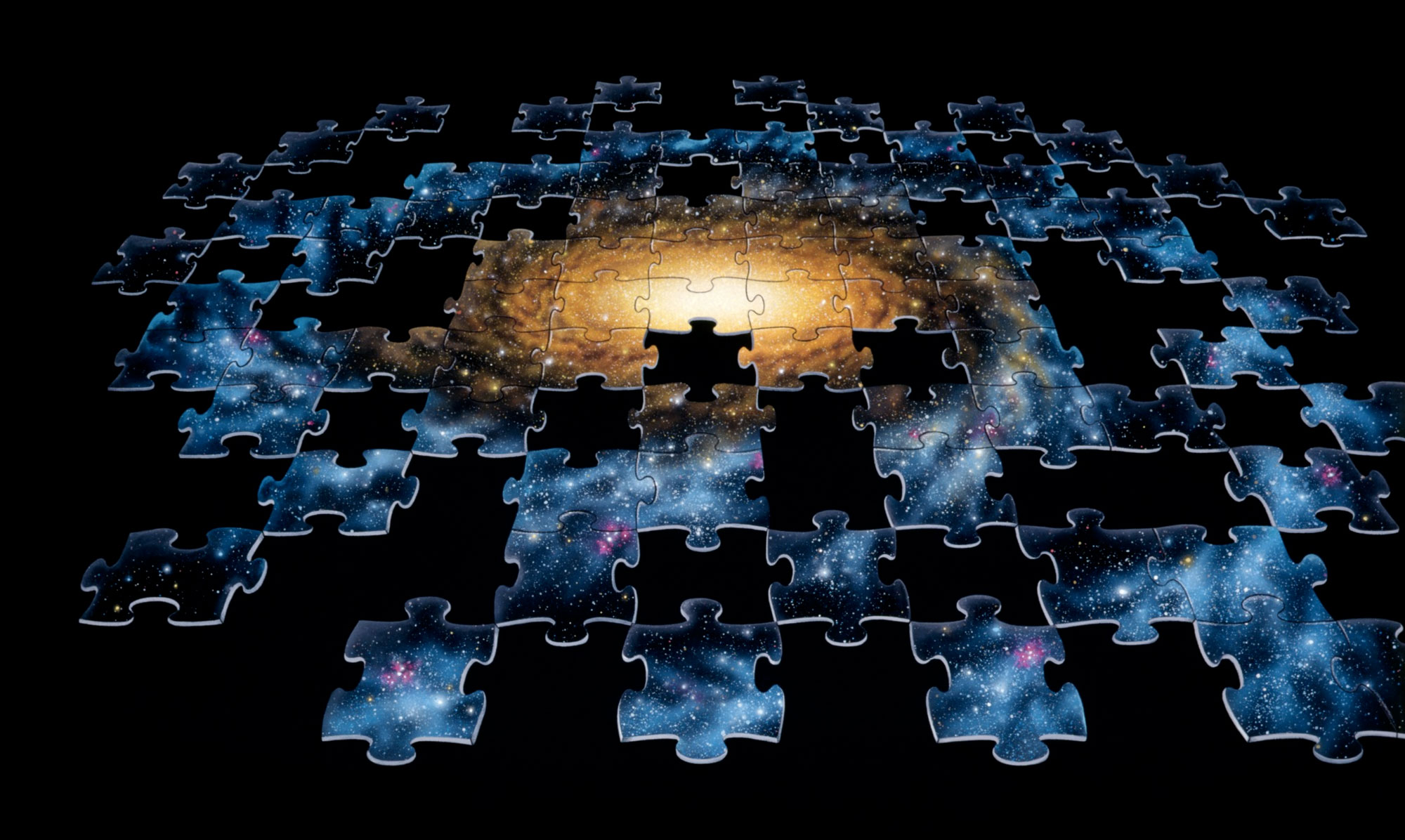



Plein Sud : Vous vous êtes, avec Colette Barbier, occupée d’une partie du commissariat de l’exposition, celle plus contemporaine localisée au premier étage du musée. Comment la thématique de l’exposition fait-elle écho à votre propre pratique ?
Nina Childress : On voit bien qu’il y a aujourd’hui un certain nombre d’artistes qui revêtent le manteau de commissaires d’exposition. Je trouve que c’est assez similaire avec le fait de faire une exposition de son propre travail. Dans tous les cas il faut faire des choix, d’autant plus quand le corpus d’œuvres est important. Ici, je connaissais personnellement la plupart des artistes sélectionnés donc c’était d’autant plus naturel. J’ai commencé par faire une maquette du musée, j’ai partagé ce que je pressentais avec Colette avec qui nous avons discuté du choix des artistes et peu à peu l’exposition s’est construite, comme une œuvre d’art !
PS : Quels artistes admirez-vous le plus dans cette exposition ?
N.C. : Je les aime tous ! Ce qui est génial c’est que grâce aux propositions de Jean-Baptiste (Carabolante, également commissaire de l’exposition, ndlr) et Colette, j’ai (re)découvert le travail d’artistes que je connaissais peu, voire pas du tout, comme celui de Mathis Collins. Ce qui était important c’est qu’il y ait une diversité, à la fois dans les générations, dans la notoriété, je voulais que ça soit assez ouvert.
PS : L’imagerie populaire, qui semble irriguer votre pratique artistique, continue-t-elle de vous inspirer aujourd’hui ?
N.C. : Quand j'ai commencé à travailler, je faisais une obsession sur Dallas, une série populaire des années 1980, pas du tout considérée par le milieu artistique. Je faisais beaucoup de caricatures des personnages, des scènes… Comme l’imagerie populaire est un champ très vaste, j’ai aussi réutilisé des images, des illustrations, des photos de jeux télévisés, de rubriques de journaux… Cette manière de procéder concerne toute une génération d’artistes, la « Pictures Generation ». Ma pratique se situe un peu après ça. J’ai été influencée par ces artistes. Une des artistes de l’exposition, Julia Wachtel qui est une artiste historique de ce mouvement, reprend le motif de la ménagère en colère représentée sur des cartes de vœux populaires aux États-Unis, c’est très parlant pour les Américains ! Aujourd’hui, pour les jeunes artistes, l’imagerie populaire n’a pas les mêmes formes, beaucoup utilisent des applications comme Snapchat pour créer ou des emojis, des logos… Il y a toujours de nouveaux éléments qui nourrissent cette imagerie qui évolue au gré des années.





PS : Qu’est-ce qu’avoir du goût selon vous ?
N.C. : L’exposition permet justement aux visiteurs d’interroger cette notion de goût, de se demander si face à telle ou telle œuvre on peut véritablement parler de bon ou de mauvais goût. Toutes les expressions à ce sujet, comme « le goût, c’est le dégoût du goût des autres » (Pierre Bourdieu, ndlr), mettent finalement en lumière le fait que le goût est quelque chose de très personnel. J’essaie toujours de m’éloigner d’un regard méprisant ou critique face aux productions artistiques. Quand je vais dans un restaurant d’hôtel, par exemple, et qu’il y a des tableaux aux murs, je les regarde sans me dire que c’est de bon ou de mauvais goût. Comme ils ne sont pas dans un endroit « prestigieux », un endroit où l’on attendrait qu’il y ait des œuvres d’art, on pourrait facilement les considérer de mauvais goût. Moi, je cherche vraiment à décloisonner tout ça.
PS : Comment explique-t-on qu’il y ait, encore aujourd’hui, une distinction entre les œuvres qui font œuvre et celles qui font objet décoratif ?
N.C. : C’est un point qui est bien abordé dans la partie de l’exposition dont nous nous sommes occupées avec Colette. Je pense que ce qui catégorise les œuvres d’art, c’est le réseau dans lequel elles circulent. Une œuvre de street-art ne se trouve pas dans le même réseau qu’une œuvre d’art contemporain qui va être montrée à Art Basel par exemple. On voit bien ce changement de réseau lorsqu’on se rend à l’hôtel Drouot face à des œuvres qui échouent et reviennent sur le marché parce que des gens revendent leur collection ou décèdent. Je trouve que c’est toujours bénéfique de déplacer son regard par rapport à cette histoire de circulation.
BEAUBADUGLY. L’autre histoire de la peinture, au MIAM jusqu'au 9 mars 2025.